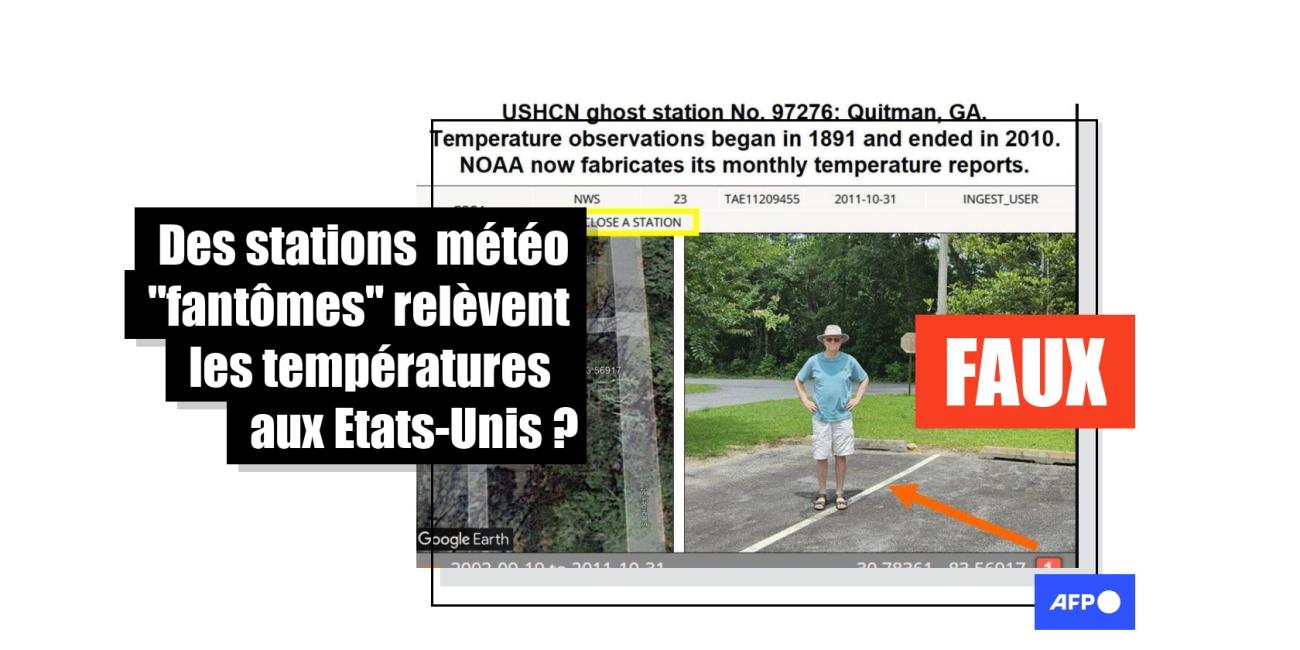Non, les aires protégées n'excluent pas les activités humaines
- Publié le 25 août 2025 à 17:56
- Mis à jour le 13 octobre 2025 à 15:08
- Lecture : 9 min
- Par : Gaëlle GEOFFROY, AFP France
Dans une vidéo postée sur YouTube le 1er juillet 2025 sur un compte se présentant comme diffusant des actualités, Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs et ex-colistier du petit parti Alliance rurale aux élections européennes de 2024, accuse l'Union européenne de construire avec ses réglementations un "kolkhoze écologique" lui permettant de "piquer votre droit de propriété". "Vous allez tous y passer", assure-t-il, citant l'exemple des "aires protégées qui arrivent (...) : on va mettre 10% du territoire national français sous aucune interactivité humaine, qu'elle soit passionnelle, traditionnelle ou économique. Et y a encore 20% qui vont se rajouter à ça. C'est-à-dire que c'est le tiers du territoire français qui va être soumis à réglementation", insiste-t-il.
La vidéo a été likée plus de 13.000 fois sur YouTube, plus de 4.000 fois sur Instagram, et relayée sur Facebook dans une multitude de petites publications, par exemple celle-ci ou celle-ci, ou sur X, comme ici.

Mais pour les experts sollicités par l'AFP, cette vidéo relaie des fantasmes sur une supposée spoliation du droit de propriété et l'étendue et la réalité des règles s'appliquant aux aires protégées, déjà présentes sur un tiers du territoire français.
Interrogé par l'AFP, le ministère de la Transition écologique a estimé le 19 août 2025 que "si ces propos reflètent une inquiétude face aux réglementations environnementales, le terme 'kolkhoze écologique' [référence au système agricole soviétique où terres et moyens de production étaient mis en commun, NDLR] est dénué de fondement. Les mesures de protection environnementale ne visent pas à supprimer le droit de propriété, mais à encadrer certaines activités pour préserver la biodiversité et les écosystèmes".
La représentation de la Commission européenne à Paris n'a, elle, pas souhaité commenter les propos de M. Schraen.
Quant à un supposé projet de "taxe au mètre carré pour votre gazon" évoqué par ailleurs dans la vidéo, il n'existe pas, ni au niveau national ni au niveau européen, comme l'ont confirmé à l'AFP les 19 et 20 août 2025 le ministère et la représentation européenne à Paris.
Contactée par l'AFP, la Fédération nationale des chasseurs a indiqué le 22 août ne pas avoir connaissance de cette vidéo car elle date vraisemblablement de la campagne de la liste Alliance rurale de Willy Schraen pour les européennes de 2024, campagne à laquelle la fédération a dit ne pas avoir pris part. Sur le fond, elle s'est refusée à tout commentaire.
Des aires protégées sur déjà plus de 30% de la France
Il s'avère que l'objectif de 30% du territoire national couvert par ces aires protégées n'est pas nouveau : il est même déjà atteint.
La stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP), présentée en 2021 et inscrite dans le Code de l'environnement, pose comme objectif "au moins 30%" des terres et des espaces maritimes français - métropole et outremers - couverts par ces aires à l'horizon 2030, dont 10% en "protection forte", c'est-à-dire avec un cadre réglementaire plus contraignant (archive). Mais en réalité, "les 30% sont atteints depuis février 2019" et "nous sommes toujours aujourd'hui autour de 33%", a indiqué le ministère de la Transition écologique à l'AFP le 19 août 2025 (archive).
Avec des chiffres légèrement différents, c'est ce que confirme la page dédiée à la France de la base de données mondiale des aires protégées au 21 août 2025 (archive) :

Niveaux de protection
Même déjà déployées, ces aires ont un impact sur la vie des propriétaires qui est très loin d'atteindre l'ampleur décrite dans la vidéo.
Pour atteindre un objectif de 30% d'ici 2030, l'Union européenne s'appuie sur son réseau de zones Natura 2000 et sur les directives Habitats et Oiseaux. Mais celles-ci n'excluent en rien les activités humaines tant qu'elles ne compromettent pas les objectifs de conservation (archives 1, 2, 3). En France, c'est ce que dit aussi le Code de l'environnement, qui transpose ces textes européens, en particulier dans son article L414-1 (archives 1, 2).
Ce cadre européen pour atteindre 30% d'aires protégées dont 10% sous protection forte "n'est pas juridiquement contraignant, et si l'Union européenne fixe des critères, elle laisse aux Etats membres le soin de décliner la notion de protection forte et les outils mobilisés pour y parvenir [principe de subsidiarité, NDLR]", a expliqué à l'AFP Simon Jolivet, maître de conférence en droit public à l'université de Poitiers, le 20 août 2025 (archive). Ainsi la stratégie nationale "ne crée pas de nouvelles catégories de zones de protection ni de nouveaux types de contraintes".
Conséquence : en France, le vocable "aire protégée" recouvre un ensemble de catégories juridiques qui avaient été créées au fil du temps, bien avant l'édiction de l'objectif européen - par exemple les parcs nationaux, les parcs régionaux, les réserves naturelles, etc.. (archive). C'est-à-dire qu'il recouvre en réalité des niveaux de protection et donc de règles très divers, souvent très souples, voire laxistes selon certains experts, très loin de la vision alarmiste véhiculée dans la vidéo virale (archive).
Cet objectif d'un tiers du territoire protégé ne serait donc qu'un affichage politique ? "Le problème du quantitatif, c'est qu'il escamote la question du qualitatif : on se focalise sur des chiffres sans se poser la question de la pertinence des outils", a résumé Lionel Laslaz, enseignant chercheur en géographie et aménagement à l'université Savoie Mont Blanc, auprès de l'AFP le 25 août 2025.
La stratégie nationale a l'avantage de "montrer une ambition", souligne Simon Jolivet, de l'université de Poitiers, mais il note aussi l'existence d'un "débat entre les spécialistes pour savoir si un parc naturel régional [PNR, NDLR] est une aire protégée ou pas. Dans ces parcs [18% du territoire selon des données officielles, sur les 30% visés, NDLR], aucune activité humaine ne peut être réglementée et encore moins interdite, car ce n'est pas le mode d'action d'un PNR. Un PNR est un espace de concertation : il vise à amener tous les acteurs, pouvoirs publics, usagers, dans une démarche favorable à la protection de la biodiversité en la conciliant avec le développement du territoire" (archives 1, 2).
Les mesures sont "souples et fixées pour chaque parc naturel régional dans une charte" d'une durée de quinze ans, renouvelable tous les douze ans, qui, après concertation, "n'intègre pas d'interdictions drastiques" et peut prévoir pour les riverains "des mesures de compensation" si des activités humaines venaient à "altérer l'environnement", a précisé Eric Landot, avocat et fondateur de Landot et associés, cabinet spécialisé dans le droit des collectivités notamment, le 18 août.
C'est que, historiquement, la présence humaine préexistait à la création de bon nombre de ces aires protégées, et certains outils, comme les parcs régionaux, ont aussi été conçus comme des outils de développement alors que la déprise rurale frappait ces territoires (archive).

Même dans les parcs nationaux, réputés protéger particulièrement la nature, c'est le droit commun qui s'applique dans les communes autour de leur coeur, dans les zones dites "d'adhésion", comme l'explique par exemple le site du Parc national de forêts, dernier en date créé en France (novembre 2019), à cheval entre la Haute-Marne et la Côte-d'Or (archive).
Superficie infime
De plus, même dans les zones sous protection forte, régies par une protection "réglementaire", c'est-à-dire des arrêtés ou des décrets (10% du territoire visé), l'Homme peut continuer à exercer des activités, y compris économiques, tant qu'elles ne portent pas atteinte à la biodiversité (archive).
C'est le cas des zones "coeur" des parcs nationaux. "Globalement, avec quelques nuances, il y a interdiction de la cueillette, de la chasse - avec des exceptions -, de faire du bruit et de survoler à moins de 1.000 mètres", détaille Lionel Laslaz, de l'université Savoie Mont Blanc, et "les textes indiquent qu'on ne doit pas modifier l'aspect du coeur", ce qui implique par exemple une demande d'autorisation pour modifier le bâti d'une maison.
"Mais le pastoralisme, l'agriculture, la pratique touristique, y existent bien [...] On trouve aussi des propriétés privées en coeur de parc national : c'est le cas pour 10% de la superficie du coeur du Parc national de la Vanoise, et dans le coeur de celui des Cévennes, 600 personnes vivent à l'année", souligne-t-il (archives 1, 2). "Il y a certes réglementation, limitation des activités [pas de VTT hors sentiers par exemple, NDLR], mais les propriétaires restent pleinement propriétaires de leurs terrains. Avoir y compris une protection réglementaire ne signifie pas perte de propriété privée".

Surtout, les espaces naturels soumis aux protections réglementaires, les plus strictes, ne concernent qu'une infime partie du territoire. Outre les coeurs des parcs nationaux, cela correspond aux réserves naturelles et biologiques, aux réserves nationales de chasse et de faune sauvage et aux zones de conservation halieutique, soit 1,35% des terres en métropole et 6,53% de la totalité des terres françaises (métropole et Outre-mer), selon un panorama au 1er janvier 2025 publié par le ministères de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique (archive).
"Les 10% seront surtout atteints grâce à de grandes aires marines protégées en Outre-mer où se concentre la majorité de la biodiversité française", a souligné le ministère de la Transition écologique auprès de l'AFP.

Libertés individuelles et intérêt général
Le ministère de la Transition écologique insiste : "Les réglementations concernées sont mises en place dans un cadre légal et démocratique, prévoyant le cas échéant des compensations et des accompagnements possibles pour les propriétaires concernés".
"Le statut de protection est indépendant du statut de propriété, et protection forte ne veut pas dire expropriation", souligne Lionel Laslaz, de l'université Savoie Mont Blanc.
Tout habitant d'une aire protégée conserve par ailleurs le droit de contester une mesure qu'il jugerait indue devant le tribunal administratif.
Il faut aussi rappeler que le droit de propriété "n'est jamais un droit absolu", souligne Eric Landot, du cabinet Landot et associés ; affirmer l'inverse relève de la "fiction", abonde Simon Jolivet, de l'université de Poitiers.
Selon l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, "la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité".

En démocratie, "aucun droit, aucune liberté, ne peut être absolu car il se heurte avec l'exercice d'un droit, d'une liberté d'un autre individu", le tout "en considération de l'ordre public", explique Simon Jolivet. Ainsi, l'appréciation du juge administratif, "c'est de dire qu'on ne prive pas du droit de propriété, on n'exproprie pas, mais il peut y avoir restriction, si elle poursuit un but d'intérêt général [par exemple la protection de la biodiversité, NDLR] et qu'elle est proportionnée à l'atteinte de ce but", précise-t-il (archive).
"La propriété privée reste garantie par la loi, et le Conseil d'Etat y est très vigilant lorsqu'il rend ses avis sur les projets de décrets de réserves nationales, ou dans le cadre de contentieux contre ces décrets", commente le ministère de la Transition écologique.
La désinformation sur une supposée spoliation du droit de propriété privée par les autorités est régulière sur les réseaux sociaux, comme l'AFP l'a montré ici ou ici. Les allégations trompeuses ou fausses sur l'environnement, vérifiées par l'AFP, sont aussi très nombreuses.
Correction d'une coquille au 27e paragrapheCorrection d'une coquille au 22e paragraphe28 août 2025 Correction d'une coquille au 27e paragraphe
28 août 2025 Correction d'une coquille au 22e paragraphe
Copyright AFP 2017-2026. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.