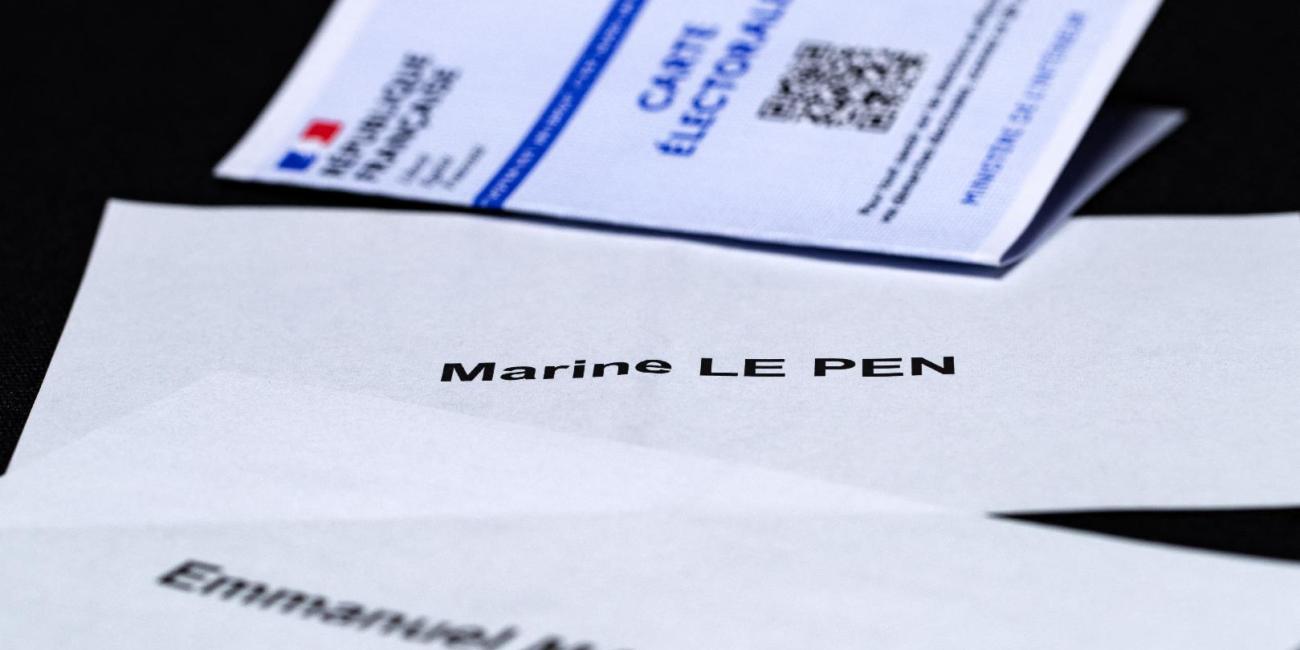Michel Barnier a-t-il raison de dire que la Constitution prime sur le droit européen ?
- Cet article date de plus de quatre ans.
- Publié le 15 octobre 2021 à 16:03
- Mis à jour le 15 octobre 2021 à 17:07
- Lecture : 5 min
- Par : Jérémy TORDJMAN, AFP France
L'onde de choc du coup de force juridique de la Pologne contre l'Union européenne n'en finit pas de se propager dans la campagne présidentielle en France. A droite, à l'extrême-droite et plus marginalement à gauche, plusieurs candidats commencent à contester eux aussi la primauté accordée au droit européen, ainsi que le rapportait l'AFP dans cet article.
Candidat à l'investiture des Républicains, l'ancien commissaire européen chargé du Brexit Michel Barnier appelle, lui, de ses voeux un retour à une "souveraineté juridique" sur l'immigration et martèle, plus généralement, que la Constitution de 1958 prime sur le droit européen.
"C'est une banalité ou c'est quelque chose que tout le monde découvre maintenant et que nous savons depuis longtemps: la Constitution est supérieure" au droit européen, a-t-il ainsi affirmé le 13 octobre sur LCI. Deux jours plus tôt sur BFMTV, il avait déjà soutenu que les normes de l'UE bénéficiaient d'une "primauté" sur les lois françaises "mais pas sur notre Constitution".
"La Constitution est supérieure, il n'y a pas de traités européens ratifiés en France en contradiction avec la Constitution. Et quand il y a une contradiction, on change la Constitution", argumentait notamment M. Barnier.
C'est toutefois loin d'être aussi simple: les décisions de justice et les explications de trois professeurs de droit public dessinent un tableau beaucoup plus complexe et une réalité juridique à géométrie très variable .
"Dire que la Constitution prime sur le droit européen est une question de point de vue", résume Edouard Dubout, professeur à l’université Paris 2 Panthéon–Assas.
Du "point de vue" européen, la question ne souffre aucune ambiguïté: contrairement à ce qu'affirme Michel Barnier, le droit issu de l'UE primerait sur l'ensemble des normes des Etats membres, "quelles qu'elles soient" et donc y compris les normes constitutionnelles.
Très récemment, la Commission l'a très fermement rappelé en réagissant au bras de fer engagé avec la Pologne. "Le droit de l'Union prime le droit national, y compris les dispositions constitutionnelles", a assuré l'exécutif européen dans un communiqué du 8 octobre.
C'est la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, devenue aujourd'hui CJUE) qui avait, la première, posé ce principe en 1964 dans son arrêt Costa . "Issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit", a décidé cette juridiction, qui se pose en gardienne de "l'interprétation uniforme du droit de l'Union".

Au fil des années, cette primauté a été réaffirmée par la jurisprudence européenne et a même été consacrée dans une des "déclarations" publiées en annexe du Traité de Lisbonne de 2007. "La Conférence (des représentants des pays membres, ndlr) rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence", proclame ainsi la déclaration 17.
L'Allemagne en a fait l'expérience en janvier 2000 quand sa règle constitutionnelle interdisant aux femmes de servir dans l'armée a été jugée par la CJUE contraire à la directive européenne de 1976 sur l'égalité entre les sexes. Un an plus tard, les premières femmes faisaient leur entrée dans les unités de combat de la Bundeswehr.
Réticences françaises
En France, les dirigeants comme les tribunaux ont toutefois rechigné à formaliser publiquement le fait qu'une norme européenne puisse primer sur la Constitution de 1958, qui tire sa légitimité de son approbation directe par référendum.
"C'est un principe de base dans la démocratie que la Constitution, acte du peuple souverain, prime", analyse Gwénaële Calvès, professeure de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise. "Il y a donc des réticences énormes à admettre un principe de primauté aussi absolu que celui formulé en 1964 (par la jurisprudence européenne, ndlr) et qui n'a jamais été approuvé par les peuples".

Par essence politique, cette réticence s'est diffusée dans les plus hautes juridictions françaises. "Vu la jurisprudence européenne, ça devrait être très simple", relève Vincent Couronne, docteur en droit public. "Mais les gouvernements ont souvent tenu un double discours, comme souvent sur les questions européennes, et n'ont jamais dit cela publiquement. Les tribunaux se sont engouffrés dans cette ambiguïté", poursuit ce juriste qui coanime le site de "legal checking" Les Surligneurs.
Même si les cas de conflit entre droit européen et Constitution sont très rares, de premières clarifications en France ont eu lieu au milieu des années 2000.
Dans une décision de juin 2004, le Conseil constitutionnel a d'abord posé qu'il refusait de contrôler la conformité à la Constitution d'une loi transposant une directive européenne car cela reviendrait en substance à contrôler la directive elle-même.
La portée exacte de cette décision a été très discutée mais, selon Gwénaële Calvès, "cette +immunité juridictionnelle+ conférée aux lois de transposition revient, de fait, à admettre la primauté du droit européen sur la Constitution".
Dans une décision très commentée rendue en juillet 2006, le Conseil constitutionnel a toutefois posé un garde-fou en jugeant qu'une loi transposant une norme européenne ne pouvait contrevenir à "l'identité constitutionnelle" de la France, rétablissant une forme de primauté --très restreinte-- de la Loi fondamentale.
Cette notion d'"identité constitutionnelle" pourrait notamment renvoyer au principe de laïcité, selon les juristes interrogés par l'AFP, mais elle n'a jamais été définie en détail depuis 2006.
"L'identité constitutionnelle est un concept permettant d'éviter de se prononcer sur cette question de primauté qui est très sensible politiquement", estime Edouard Dubout.
Très récemment, le Conseil d'Etat a lui aussi posé une autre limite à la primauté du droit européen sur la Constitution. Dans sa décision d'avril 2021 liée à la conservation des données de téléphonie, la haute juridiction administrative a jugé que la Loi fondamentale pouvait primer sur le droit européen dans les très rares cas où celui-ci n'apporterait pas des protections "équivalentes" aux citoyens en termes de libertés publiques.
Quid des traités ?
Selon Michel Barnier, le fait que les traités européens ne peuvent être ratifiés si certaines de leurs dispositions sont contraires à la Constitution --principe posé dans son article 54-- démontre la primauté de la Loi fondamentale.
Cet argument est toutefois à double sens puisque, s'agissant de l'Europe, c'est la Constitution - et non le traité - qui a été modifiée pour résoudre ces conflits quand ils sont survenus, notamment en 1992 un an avant la signature des accords de Maastricht.
"L'article 54 a souvent été présenté à tort comme le signe du primat constitutionnel sur le droit de l'UE", notait dans un article de 2019 Baptiste Bonnet professeur à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Cette lecture fait fi de l'interprétation inverse tout aussi correcte (...) qui consiste à relever que l'incompatibilité d'un traité avec la norme constitutionnelle signifie en général une révision constitutionnelle et jamais la modification du Traité".
Copyright AFP 2017-2025. Toute réutilisation commerciale du contenu est sujet à un abonnement. Cliquez ici pour en savoir plus.